conso 7 retraite


« Ma
retraite? parce qu’elle
le Woerth bien ! »
petite histoire d’une vieille amie des vieux (1)
« Défendons la répartition ! » « Retrait du projet Fillon ! » Le 7 septembre dernier, nous étions près d’un million selon la police et plus de deux millions selon les syndicats à nous époumoner dans les rues pour le maintien en France de la retraite à 60 ans (2). Pardon? Vous étiez là aussi? A la bonne heure... Donc, je brandissais comme vous le poing en hurlant... Mais quantité de questions ne cessaient de tournoyer dans ma tête : je défilais certes, mais pour défendre quoi exactement ? Le système pour lequel je mouillais ma chemise était-il équitable? Etait-il viable ou complètement ingérable? Mais au fait, d’où venait-il? Qui l’avait inventé? De retour à la maison, j’ai voulu en savoir plus. Voici le résultat de ma petite enquête. Elle est succincte. D’accord. Ecrite à cent à l’heure. OK. Elle pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses. C’est vrai. J’espère simplement qu’elle vous aidera à essayer par vous-même d’y voir plus clair...
Une idée moderne, la retraite? Non. C’est une invention de la Rome impériale. Du moins aussi loin que les historiens se souviennent... A Rome, les vétérans qui n’avaient pas démérité « quittaient les Aigles », comme on disait à l’époque, avec dans leur besace un pécule de douze mille sesterces. Soit douze années de solde d’un légionnaire de base. A cette prime de démobilisation, venait s’ajouter une épargne bloquée plafonnée à 250 deniers : ni plus ni moins que l’équivalent d’une retraite par capitalisation ! Les primes étaient, elles, puisées sur l’aerarium militare – le « trésor militaire », lui-même approvisionné par des taxes très impopulaires sur les héritages (5%) et les ventes (1%). Rien de nouveau sous le soleil : en gestionnaire retors, Rome s’employa au cours des âges à contenir la charge des sommes versées aux vétérans. Il ne trouva rien de mieux que d’allonger comme aujourd’hui la durée du service actif, qui passa de 16 ans sous le consul Marius (157-86 av. J.-C.) à 25 ans sous l’Empereur Auguste (63 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.)...
Les débats à Rome sur les retraites étaient, paraît-il, aussi houleux qu’au Palais-Bourbon ! et les arguments massues pleuvaient aussi drus : « Tibère soutint mordicus que la République succomberait si la période de service de ses légionnaires était réduite à vingt ans… », rapporte l’historien romain Tacite. Cynique, l’Empereur accorda très peu de congés à ses légionnaires, m’apprend l’historien Suétone. Son but ? Qu’ils trépassent avant de toucher leur prime ! L’ignominieux calcul s’avéra payant puisque, selon l’historien A.R. Burns, le taux de mortalité des légionnaires romains était tellement élevé qu’un sur deux n’arrivait jamais à l’âge de la retraite - qui était de 42 ans !
Les retraités de 2010 sont heureusement mieux lotis que les légionnaires romains. L’immense majorité d’entre eux atteint les 60 ans en pleine forme : la durée moyenne de la retraite en France est de 22 ans pour les hommes et de plus de 26 ans pour les femmes. Autre différence, de taille : le système romain était financé par les impôts ; dans la France contemporaine, ce sont les actifs eux-mêmes – salariés et employeurs – qui paient pour les retraités. Cette logique, dite de « répartition », diffère, comme vous le savez sûrement, de la retraite « par capitalisation », qui est celle des fonds de pension américains, par exemple. Ces organismes placent en bourse les sommes épargnées par les contributeurs, jusqu'à leur départ en retraite. Les intérêts cumulés serviront à leur verser un revenu. Si la bourse, entre temps, ne s’est pas effondrée. Ce qui a été toujours le cas dans l’histoire…
« Tout juste de quoi vivre… »
En France, c’est Colbert, alors ministre de Louis XIV, qui créa pour les marins de la Royale le premier système de retraite par répartition. Vous avez bien lu. En pleine période d’absolutisme royal, voici que les plus riches payaient pour les plus pauvres ! Le système était en effet financé par une cotisation prélevée sur la seule solde des officiers de marine. Récusons au passage l’idée reçue qui attribue l’invention des systèmes de retraite aux gouvernements socialistes ou socio-démocrates, adeptes de « l’Etat Providence. » Les pionniers en la matière furent des régimes autoritaires au premier rang desquels le second Empire de Napoléon III et le Reich allemand de l’Empereur Guillaume II.
C’est en 1853 que fut généralisée en France la retraite à 60 ans pour les fonctionnaires civils et militaires du Second Empire, mais aussi les marins du commerce et de la pêche, les agents de la Banque de France et de l’Imprimerie Nationale et les comédiens du Théâtre Français. Pardon? Oui, c’est ça : ce sont les fameux « régimes spéciaux » dérogatoires qui font tant jaser aujourd’hui. A l’époque, les pensions servies par ces régimes étaient bien faibles : « dix-huit cents francs au plus ; avec les petites rentes que je tiens de mon père, c’est tout juste de quoi vivre… », se désole, dans une nouvelle de l’écrivain Joris-Karl Huysmans datant de 1888, un certain Bougran, rond-de-cuir mis à la retraite un peu plus tôt que prévu. « Heureusement que ma vieille bonne Eulalie et moi-même, nous vivons de rien ! », se console ce pauvre Bongran.
“Vivre de rien”. C’est en effet le lot de la majorité des vieillards de la France du XIXe siècle. Le pays est encore essentiellement rural et le salariat, qui permet de cotiser pour une future pension, reste ultra-minoritaire. Avant 1914, m’apprennent les historiens, un retraité sur trois vit d’une rente, en général foncière. Les plus riches ajoutent à ce revenu les intérêts d'un capital économisé pendant la vie active : « L'inflation étant quasiment nulle, leur pouvoir d’achat ne bougea presque pas entre 1815 et 1914 », affirme l'économiste Thomas Piketty. En 1804, apparaissent les premières Caisses de secours mutuel destinées à accueillir les économies ou les cotisations des ouvriers : « Elles sont si pauvrement dotées que presque aucune n'atteint d'une manière durable le but de son institution », regrette le médecin Louis René Villermé, qui réalisa en 1840 une enquête célèbre sur la condition ouvrière en France (à lire !).
Ces caisses de secours, ainsi que les caisses de prévoyance qui apparaissent au même moment, sont si peu utilisées qu’en 1890 seuls 3,5 % des ouvriers âgés ont accès à une pension ! « Les agriculteurs, poursuit Villermé, préfèrent pour leur vieux jour tenir leur argent caché, l'enfouir, le garder improductif, ou bien acquérir à un prix exorbitant, un coin de terre ou une masure... » Quant à la cohorte, immense, des pauvres, elle ne peut compter que sur la solidarité familiale : « Le père du cantonnier-poseur de voie Clovis X. a demandé à ses enfants une pension alimentaire de 400 F pour ses soixante-dix ans. (…) Sa femme restera courbée sur des travaux de couture payés à la tâche… », rapporte le sociologue Frédéric Le Play, dans une monographie datant de 1901 consacrée audit Clovis X (à lire !).
Pendant ce temps, de l’autre côté du Rhin, le Reich de l’empereur Guillaume II est à l’origine d’une avancée sociale majeure. Eh oui ! Pas drôle à dire, mais vrai... Pour s’attacher la classe ouvrière et contrer les menées socialistes, son chancelier Bismarck instaure en 1883, à la surprise générale, le premier système d’assurance obligatoire au monde. Financé à la fois par les cotisations ouvrières et patronales, il donne droit à une retraite à l'âge de soixante-dix ans, après trente ans de cotisations. L’âge est vénérable et la pension modeste, mais quel progrès par rapport à la France où les ouvriers doivent imposer par les luttes sociales le principe même de la retraite au patronat !
Les mineurs y parviennent en 1894. Les cheminots obtiennent leur caisse en 1909. L’idée d’un droit à la retraite pour tous les salariés prend corps en 1910, avec les « R.O.P. » (Retraites ouvrières et paysannes). Mais, bien que légères (9 F par an pour les ouvriers et les patrons) les cotisations ne sont toujours pas obligatoires. L'âge de la retraite est fixé quant à lui à soixante-cinq ans : « C'est la donner à des morts ! », s’étrangle la CGT, qui fait, contre toute attente, campagne contre le projet ! Passé un moment d’ahurissement, je comprends pourquoi : « Dans les années 1910, à peine 8% de la population atteint l’âge de soixante-cinq ans, dont une infime minorité d’ouvriers… », m’apprend l’historien Jean-Michel Gaillard…
Autant dire qu’à la veille de la première guerre mondiale, la retraite n’est encore qu’un rêve inatteignable pour la plupart des Français. D’autant que le système de 1910 s’avéra totalement inefficace pour ses rares bénéficiaires ! Mobilisés en 1914, les cotisants cessèrent massivement d’assurer leurs versements et les caisses firent faillite : « La plupart avaient investi dans des titres à revenus fixes, écrasés par l'inflation, et des valeurs étrangères, notamment russes et ottomanes, qui furent à jamais perdues », me rappelle l’historien genevois Youssef Cassis. Il faudra attendre la Loi du 30 avril 1930, pour que soit enfin créé en France le tout premier régime d’assurance-vieillesse obligatoire pour tous. Las ! Lui aussi était basé sur le principe de la capitalisation. Cette fois-ci, c’est la dévaluation du Franc par Raymond Poincaré en 1928, la crise de 1929 et l’inflation galopante des années trente qui réduisit à néant les pensions des contributeurs…
J’avais pieusement appris que les ordonnances de 1945 du conseil national de la résistance avaient remplacé en France la retraite par capitalisation par le système intégral de répartition. C’était faux ! Il fut instauré en mars 1941, par René Belin, un ancien dirigeant de la CGT, devenu ministre du Travail du régime de Vichy. C’est tout de même Pierre Laroque, considéré comme le père fondateur de la Sécurité Sociale, qui fut chargé par Alexandre Parodi, alors Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de mettre cette mesure en application après la Libération. Le système donne alors droit à une pension de 40 % du salaire de référence, à partir de soixante-cinq ans.
Une nouvelle « race » de retraités...
Les retraités d’après-guerre sont-ils enfin sortis d’affaire ? me demandai-je. Loin s’en faut ! me répondent sociologues et historiens. En 1948, 63 % des plus de 65 ans touchent certes un revenu de vieillesse, qu’ils nomment « retraite ». Mais dans les faits, la plupart d’entre eux ont très peu cotisé et leur situation reste précaire : « Jusque dans les années 1960, la moitié des retraités ne touche que le ‘minimum vieillesse’, qui correspond à un tiers du Smic de l’époque, c’est-à-dire quasiment rien », m’indique le sociologue Louis Chauvel, lors d’un entretien qu’il a bien voulu m’accorder. Et tout à coup je me souviens de la chanson de Pierre Perret: « On l’appelle cuisse de mouche fleur de banlieue, sa taille est plus mince que la retraite des vieux… ». C’était en 1968… Dix ans plus tôt, un Fonds national de solidarité (FNS), théoriquement alimenté par le produit de la vignette automobile, avait pourtant été créé : il n’a jamais servi (voir mon petit historique à gauche). Pour la majorité des personnes âgées, la retraite signifie encore la relégation au terrible « hospice des vieux », raconte l’historienne Elise Feller : « un lieu de vie frugale, de soins médiocres, de mortalité élevée, et de perte de l’espace privé ».
Très vite, on s’aperçoit que la « retraite de base » servie par la Sécurité sociale est insuffisante, et qu’il faut lui ajouter d’autres sources de revenu : c’est à cette fin que voient le jour les « caisses complémentaires ». En 1947 avait été créé l’AGIRC, une Caisse complémentaire à destination des cadres d’entreprise. A l’origine du projet, la Confédération Générale des Cadres (CGC), qui défend bec et ongle le système de répartition : « Il doit éloigner le cadre du spectre de pauvreté médiocre d’une petite retraite et lui garantir un niveau de revenu comparable à celui qu’il avait autrefois… », plaide l’ingénieur Fournis au congrès national de la CGC du 24 juin 1945 (lu dans l’excellent bouquin du sociologue Luc Boltanski, Les cadres). Ce sera bientôt le cas. Grâce à l’AGIRC, les cadres seront les premiers en France à percevoir une retraite confortable à partir de la fin des années 1970, leurs pensions suivant les majorations de salaires, en cette période de forte inflation, par le biais de la fameuse « échelle mobile des salaires ». Vous vous souvenez ? Les non-cadres, eux, n’obtiendront leur caisse complémentaire qu’en 1961 (ARRCO). L’adhésion à ces organismes n’étant pas obligatoire, le système généralisant la retraite complémentaire à tous les salariés du secteur privé ne verra le jour qu’en 1973.
Retraite de base généralisée, caisses complémentaires généreuses, elles-mêmes nourries par une expansion économique sans précédent : Tout est désormais en place pour qu’apparaisse, à l’orée des années 1980, une nouvelle « race » de retraités. Celle des personnes nées dans les années 1930, qui ont effectué leur carrière durant les « trente glorieuse » - « souvent dans la même entreprise, sans subir le chômage et régulièrement augmentés et promus… », détaille le sociologue Louis Chauvel. Un rêve que beaucoup de salariés d’aujourd’hui ne connaîtront malheureusement plus… Ce sont les membres de cette génération, qui vont prendre sa retraite, voire leur « préretraite », à partir du milieu des années 1980…
Leur situation n’a plus rien à voir avec celle de leurs aînés. Le minimum vieillesse ? Il ne concerne plus que 5% d’entre eux ! En France, le revenu mensuel moyen d’un retraité est aujourd’hui de 1500 euros – un chiffre, qui, certes, cache de grandes disparités. Rien de commun, en effet, entre ce que touchent par exemple en moyenne les femmes (1000 euros mensuels) et les hommes cadres de la fonction publique (2800 euros) ou même du privé (2600 euros) – ces derniers disposant pour leurs vieux jours d’un pouvoir d’achat désormais plus élevé que celui d’un ménage moyen d’actifs ! « Les retraités n’ont globalement jamais été aussi à l’aise financièrement, me confirme Louis Chauvel. D’autant qu’ils n’ont plus d’enfant à charge et que plus de 70 % d’entre eux sont propriétaires de leur logement…»
Je constate en effet que leur poids économique est tel qu’ils sont devenus une clientèle de choix pour les experts en marketing. Totalisant 280 Milliards d’euros - plus de 14 % du PIB ! - les pensions versées constituent une manne énorme pour les secteurs de la santé et des loisirs, mais aussi de l’automobile, de l’habillement ou des nouvelles technologies, le retraité étant un excellent consommateur. Selon une enquête du Credoc (3) publiée cette année, la consommation annuelle moyenne des ménages chez les personnes de 60 à 69 ans – dénommées « seniors actifs » ou « jeunes seniors » par les marqueteurs – est de… 24.865 euros !
Les industriels rivalisent d’inventivité pour séduire cette cible juteuse : les opérateurs de téléphonie mobile SFR, Orange, Temo ou Prixtel multiplient les offres ciblées ; des chaînes comme Best Western font de même dans l’hôtellerie ; le distributeur Casino se lance dans les services à la personne ; le marché des croisiéristes explose tandis que les boutiques dédiées aux seniors, comme Hojo, voient le jour un peu partout en France. « D’ici à 2050, il y aura plus de personnes de 60 ans et plus, que de personnes de moins de 15 ans », note dans une étude récente, la société de conseil Alcimed. La marque de café Maxwell l’a compris : elle a créé un couvercle à ouverture facile pour son café instantané qui porte le logo de l’« Arthritis Foundation »...
Quant aux produits alimentaires de grande consommation, il suffit de se balader dans les grandes surfaces pour constater qu’ils s’enrichissent, à grand renfort de publicité, en phytostérols pour faire baisser le taux de cholestérol (Danacol, Proactiv…) ou en aliments comprenant du collagène et de la glucosamine pour « soigner les articulations ». Je n’oublie pas les constructeurs automobiles, qui multiplient avec profit les modèles de roadsters, dont j’ai appris qu’ils étaient particulièrement appréciés par les nouveaux retraités issus de la « génération du baby boom ». Car contrairement à ce que je pensais, la voiture préférée des seniors européens n’est pas le break pépère, mais… l’Audi TT, une sportive à toit ouvrant, qui vous fait passer de 0 à 100 Km/h en 7,7 secondes ! Sensation garantie à partir de… 64 000 euros.
Dois-je m’en réjouir ? Me rouler par terre en criant à l’injustice ? A vrai dire, je n’en sais rien. A vous de voir. « Le système actuel des retraites paraît financièrement intenable », met en tout cas en garde Louis Chauvel. En raison de la forte croissance du nombre de retraités (+ 280 000 par an depuis 2006) et de la baisse du nombre des cotisants (un actif pour deux retraités, au lieu d’un pour quatre dans les années 1960) les régimes sont confrontés à des déficits vertigineux. En France, ils totalisent aujourd’hui plus de 32 Milliards d’euros. Et si rien n’est fait, ils iront en s’aggravant dans les années à venir : « 70 Milliards € en 2030, 100 Milliards € en 2050… », égrène le rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié en avril dernier (j’ai pu le lire en ligne, voire l’adresse ci-dessous). « Ces sommes sont - et seront - payées par des actifs de plus en plus précarisés, qui ont à peine de quoi vivre et se loger, et qui ne bénéficieront jamais des revenus des retraités d’aujourd’hui », se lamente Louis Chauvel, qui a fait de la défense des jeunes générations précaires sont cheval de bataille.
La faillite du système sonnera-t-elle alors le glas des retraites ? Réussira-t-on, au contraire, à sauver à temps ce qui constitue encore à ce jour une avancée sociale majeure dans l’histoire de l’humanité ? En augmentant les prélèvements effectués sur les retraités et sur les revenus du capital, comme le suggèrent certains experts (CSG, participation aux dépenses de santé publique des personnes âgées…) ? En généralisant le système par capitalisation, au risque de ruiner toute une classe d’âge, comme il y a trois ans en Argentine ? En multipliant les mesures de « replâtrage », jusqu’à l’extinction probable du système, comme l’ont fait jadis les Empereurs romains, et comme le tente aujourd’hui le gouvernement Fillon ? Ou en fondant toutes les caisses en une seule, en supprimant les systèmes de retraite complémentaire, chapeau et capitalisées, qui accentuent les inégalités de situations (elles reflètent, et c’est par là qu’il faudrait peut-être d’abord agir, les inégalités salariales, dont on ne parle jamais, et qui n’ont cessé d’augmenter durant ces 25 dernières années...), en montant de plusieurs crans le minimum vieillesse, afin que les salarié(e)s précaires - femmes et jeunes en tête - puissent espérer vivre une vieillesse décente, tout en instaurant un plafond maximal de revenu de retraite? Je vous l’avais dit, ma petite enquête soulève des tonnes de questions. Mais, après tout, qui suis-je pour prétendre délivrer des réponses toutes faites?
Texte et dessin Jean-François Paillard - octobre 2010
- - -
(1) Cet article a été publié sous une forme amodiée dans l’excellente revue mensuelle ça m’intéresse.
(2) Le même jour, l’Assemblée Nationale entamait dans une atmosphère survoltée l’examen du projet du gouvernement, qui repousse de deux ans l’âge légal de départ (62 ans) et rallonge de quatre annuités la durée de cotisation (41 ans et six mois). -
(3) Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie.
- -
Bibliographie :
Feller (Élise), Histoire de la vieillesse en France, 1900-1960. Du vieillard au retraité. Paris, Éditions Seli Arslan, 2005, 352 pages. Un ouvrage exhaustif et érudit sur la vieillesse en France, de la loi de 1905 instituant l'assistance obligatoire aux « vieillards indigents » jusqu'au rapport Laroque, qui dessina les contours du « troisième âge ».
Bruno Palier, La réforme des retraites, PUF, collection "Que sais-je ? », 2003 (mise à jour mars 2010). Un tableau clair des différents systèmes de retraites en France aujourd’hui. A lire toute affaire cessante, si l’on veut comprendre les enjeux futurs, qui annoncent la montée des inégalités entre jeunes générations et retraités d’aujourd’hui.
Lordon Frédéric, Fonds de pension, piège à cons ?, Paris, Le Seuil, « Raison d’agir », 2000. Un petit ouvrage irrévérencieux et percutant qui dénonce l'utopie sociale qui porte les fameux fonds de pension et qui risque de transformer notre société en démocratie actionnariale, où certains seront peut-être moins égaux que d’autres…
Sites internet :
http://www.fgaac.org/principal.php?page=histoiredesretraites Pour en savoir plus sur l’histoire de la retraite des cheminots
http://www.caes.cnrs.fr/Publications/archives/caes-magazine/CAESMag-67/Retraites.pdf Une brève histoire des régimes de retraite.
http://www.histoire.presse.fr/content/2_partage/article?id=1925 Un bel article sur le sujet, de l’historien Jean-Michel Gaillard, dans le magazine l’Histoire.
http://www.observatoire-retraites.org/ Le site de l’observatoire des retraites
http://www.retraites2010.fr/ La présentation du projet du Gouvernement relatif à la réforme des retraites.
Citations :
« Nulle retraite n'est plus tranquille ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme », Marc Aurèle.
« Il en coûte trop cher pour briller dans le monde, combien je vais aimer ma retraite profonde ! Pour vivre heureux vivons cachés », Jean-Pierre Florian, in Le Grillon
« M. Bougran rentra dans sa pièce et s’affaissa, anéanti. Puis il eut l’impression d’un homme qu’on étrangle; il mit son chapeau et sortit pour respirer un peu d’air. Ainsi, c’était vrai; il était mis à la retraite! Lui qui s’était dévoué jusqu’à sacrifier ses dimanches, ses jours de fête pour que le travail dont il était chargé ne se ralentît point. Et voilà la reconnaissance qu’on avait de son zèle! », J.-K. Huysmans, in La retraite de Monsieur Bougran, 1888
« Le régime de Vichy transformera notre système de retraite par capitalisation, ruiné à la suite de la crise, par le système beaucoup plus sûr de la répartition », Jean-Marie Harribey, économiste, à l’université de Bordeaux, 1941.
« Nous n’avons pas la mentalité ni les règles des petits retraités. (…) Il est indigne de réserver aux cadres, à partir du moment où ils ne sont plus en âge de travailler, une position telle qu’ils ne puissent plus assumer le même rang qu’ils avaient auparavant et qu’ils soient obligés d’aller cacher dans une lointaine province leur pauvreté médiocre. », Yves Fournis, secrétaire général de la C.G.C., juin 1945.
« Les trois grandes époques de l'humanité sont l'âge de la pierre, l'âge du bronze et l'âge de la retraite », Jean-Charles, in extrait du recueil de paroles d'élèves La Foire aux cancres.
« Pour la retraite, la plume est moins utile que la tondeuse à gazon », Daniel Pennac, in La Fée Carabine, 1987.
« Si la retraite en capitalisation se développe (…), il faudra s’attendre à des cotisations plus élevées pour les femmes, qui vivent plus longtemps que les hommes, à des coûts plus importants pour les bas salaires, les frais fixes étant élevés, et à une insécurité accrue des placements, à cause des aléas boursiers. (…) Les personnes ayant subi de nombreuses interruptions de carrière, femmes en tête, seront les principaux perdants », Bruno Pallier, chercheur au CNRS, 2003.
« Les maisons de retraite, c'est comme les colonies de vacances, sauf qu'il n'y aura pas de rentrée des classes », Patrick Timsit.
« Les hommes publics sont comme les filles publiques, incapables de prendre leur retraite à temps », Claude Frisoni, Extrait de Frisoni soit qui mal y pense.
« Au bout de quinze ans de chômage, on devrait avoir droit à une retraite de chômeur »,Georges Wolinski, in Les Pensées.
« Puisqu'il faut cotiser plus longtemps et qu'on ne veut pas prendre notre retraite plus tard, il faudrait réformer les années en les faisant passer de douze à quinze mois... », Laurent Ruquier, in Vu à la radio.
« Pour les acteurs et pour les chefs d'Etat, il n'y a pas d'âge pour la retraite », Alain Delon in Le Monde, 18 Juin 2003.
jeudi 2 décembre 2010
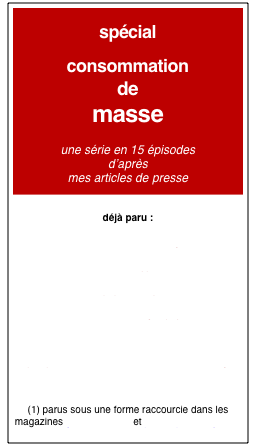









Quelques
repères chronologiques
13 av. J-C
L’empereur Auguste finance par l’impôt la retraite de ses légionnaires
Sous la Rome impériale, l'armée était composée d’engagés volontaires. L’empereur Auguste (63 av. J.-C. 14 ap. J.-C.) fixa la durée du service à 25 ans. Engagé à 18 ans, un légionnaire quittait donc la Légion à quarante-trois ans, « son corps usé par l’âge et généralement mutilé par les blessures… » (Tacite, Annales, I, XVIII). Il retrouve alors un petit capital épargne, plafonné à 250 deniers. Il bénéficie surtout d’une prime de démobilisation ou d’une dotation en terre substituée à celle-ci. Auguste fixa la prime de retraite à douze mille sesterces ou trois mille deniers, soit douze années de la solde de base d’un légionnaire. Pour financer cette prime, il créa l’aerarium militare , le « Trésor militaire », approvisionné par le «Vingtième », une taxe de 5% sur les héritages et le « Centième », une taxe de 1% sur toutes les ventes. Déjà à l’époque, des critiques s’élevaient à propos de la charge financière des retraites des vétérans et de la période de service des bénéficiaires ! « Le peuple, nous apprend l’historien romain Tacite (55-120 ap. J.-C), demandait la suppression de l’impôt du centième. Tibère déclara par un édit que ce revenu était la seule ressource du trésor militaire et que même la république succomberait si la vétérance était reculée jusqu’à la vingtième année de service » (Tacite, Annales, I, LXXVIII). L’Etat romain s’employa d’ailleurs à maintenir le plus possible les légionnaires sous les Aigles, allongeant au cours des âges la durée du service (qui passa de 16 ans à 25 ans). « Il accorda très peu de congés aux vétérans, écrit à cet égard l’historien Suétone (70-130 ap. J.-C.), espérant que la vieillesse apporterait la mort, et que la mort lui profiterait. » ( Suétone, Tibère, 48, 5) Un calcul profitable puisque selon l’historien A.R. Burns (1), un légionnaire romain sur deux n’arrivait pas à la retraite!
(1) A.R. Burns, « Hic breve vivitur, a Study of the Expectation of Life in the Roman Empire”, Past and Present, 1953, pp.1-31.
1673
La retraite par répartition ? Une invention de la monarchie absolue !
Incroyable mais vrai. Symbole de justice et d’humanité, la retraite est une invention… de l’absolutisme royal ! Premier régime de retraite en France, celui de la marine Royale (ordonnance du 19 avril 1673) est une invention de Colbert, ministre de Louis XIV. Financé par une cotisation prélevée sur la solde des officiers de marine, c’est aussi le premier régime par répartition au monde. En 1768, une opération identique est réalisée à destination des employés des impôts (Ferme générale).
1853
En France, Napoléon III chouchoute ses fonctionnaires…
Six mois presque jour pour jour après que Louis-Napoléon a instauré le Second Empire, une loi organise un régime de pension par répartition des fonctionnaires géré par l’État (Loi du 9 juin 1853). Magnanime, elle fixe l’âge normal de départ à la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les travaux pénibles. Les bénéficiaires sont non seulement les fonctionnaires civils et les personnels militaires, mais aussi les marins du commerce et de la pêche, les comédiens du Théâtre Français, les agents de la Banque de France et de l’Imprimerie Nationale. En dehors du secteur public, le développement de l’assurance-vieillesse est beaucoup plus timide. En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, des premiers dispositifs sont apparus en 1804, avec les Caisses de secours mutuels, mises en place par les ouvriers eux-mêmes et très pauvrement dotées.
1883
…Tandis qu’en Allemagne Bismarck, chancelier du Reich, étend la retraite aux ouvriers.
De l’autre côté du Rhin, un autre état autoritaire – le Reich allemand de l’empereur Guillaume II – est, lui aussi, à l’origine d’une avancée sociale majeure. Afin de s’attacher la classe ouvrière et contrer les menées socialistes et socio démocrates, Bismarck instaure un système d’assurance obligatoire par répartition, financé à la fois par les cotisations ouvrières et Patronales. Pendant longtemps, ce système véritablement révolutionnaire sera, de loin, le plus avancé au monde ! Jusqu’en 1910, les caisses de retraites ne concernent en France que quelques corps de métiers à l’avant-garde des luttes sociales (mineurs en 1894, cheminots en 1900, chemins de fer en 1909)
1910
En France, l’idée d’un droit à la retraite pour tous les salariés prend vraiment corps avec la Loi du 5 avril 1910 créant les R.O.P. (Retraites ouvrières et paysannes).
Ces retraites volontaires étaient assises sur la capitalisation, l’épargne personnelle bénéficiant individuellement aux souscripteurs. Las ! Mobilisés en 1914, les cotisants cessèrent massivement d’assurer leurs versements et les caisses firent faillite les une après les autres (trouver des exemples…) Il faudra attendre la Loi du 30 avril 1930 pour que soit créé en France le tout premier régime d’assurance-vieillesse obligatoire pour les salariés un mixte de capitalisation et de répartition. Là encore, la capitalisation permit d’accumuler des sommes importantes. Mais cette fois-ci, c’est l’inflation galopante des années trente qui réduisit les montants à néant, aggravant la misère de bon nombre de personnes âgées.
Années 40 :
Triomphe de la retraite par répartition.
C’est sous le régime de Vichy et non à la Libération, comme on le croit souvent, que fut généralisé en France le passage au système intégral de répartition (Loi du 14 mars 1941). La même Loi instaure l’Allocation aux Vieux travailleurs salariés pour venir en aide aux anciens salariés dépourvus de ressources et non couverts par le régime des A.S. Le système est mis en place par un certain René Belin, ancien dirigeant de la CGT devenu ministre du Travail du régime de Vichy. La loi du 22 mai 1946 institue les régimes de base de tous les assurés sociaux, quelle que soit leur profession, et encadre la création des régimes de retraite complémentaire obligatoires. C’est Pierre Laroque, père fondateur de la Sécurité Sociale, qui fut chargé dès septembre 1944 par Alexandre Parodi, Ministre du Travail et de la Sécurité sociale du premier gouvernement de la France libérée, de mettre en œuvre le Plan français de protection sociale, dont le projet avait été finalisé à Alger par le Comité de Libération Nationale. L’âge de la retraite prévu par l’ordonnance de 1945 est 65 ans. ..
1953
Les premières grèves au secours des retraites
La première attaque directe contre le système en place interviendra en 1953. Elle visera, d’une part les régimes spéciaux (entreprises nationalisées et services publics) jugés trop généreux et devant être alignés sur le secteur privé et, d’autre part, l’âge de départ en retraite - 65 ans - que l’on proposait déjà à l’époque de reculer en raison de l’augmentation de l’espérance de vie. Il en résultera un mouvement de grève fulgurant qui, partant du « public » entraînera le « privé » paralysant la France en plein milieu des vacances. Grâce à ce mouvement de grèves sans précédent, cette première « contre-réforme » sera aussitôt retirée.
1956
Le scandale de la « vignette auto »
En 1956, pour améliorer le sort des pensionnés n’ayant pas ou ayant faiblement cotisé pour leur retraite, est créé le Fonds national de solidarité (FNS), alimenté principalement par une taxe perçue sur les véhicules automobiles.Pendant plus de quarante ans, les gouvernements de la IVe et de la Ve République, percevront cette taxe (dite « vignette-auto ») de plus en plus « juteuse », du fait de l’énorme extension du parc automobile, sans que les vieux nécessiteux en profitent le moins du monde...
1962
Pierre Laroque doute déjà de la pérennité de son « bébé ».
En 1962, Pierre Laroque, considéré comme le « père fondateur » de la Sécurité sociale de 1945, publia un rapport concluant à un grave danger encouru par les régimes de retraite, en raison de l’évolution démographique de la France. Unanimement salué pour sa pertinence, ce texte sera oublié, dès lecture faite, et les choses suivront leur cours, comme si de rien n’était ! En 1970, Laroque récidivera, sans plus de succès avec un rapport sur le vieillissement de la France.
Années 50 à 70
Naissance des retraites complémentaires, filles des « Trente glorieuses »
On s’aperçut vite que la retraite servie par la Sécurité sociale était insuffisante et qu’il fallait lui ajouter d’autres étage. Dans ce dessein, on eut recours à des « caisses complémentaires » qui, branche par branche, verront le jour rapidement. Elles fonctionneront, elles aussi sur le principe de la répartition. En 1947, est créée une Caisse complémentaire des cadres (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres, AGIRC) et en 1961, une caisse complémentaire des salariés non-cadres (Association des Régimes de Retraite COmplémentaire, ARRCO), l’une et l’autre coordonnant 46 caisses au rendement très varié et concernant de multiples branches. Toutefois, l’adhésion à ces organismes n’était pas obligatoire. Le système généralisant la retraite complémentaire à tous les salariés du secteur privé ne verra le jour qu’en 1973. Ces dispositions améliorent la situation des retraités, d’autant que les pensions suivront d’assez près les majorations de salaires fréquentes et substantielles en cette période de forte inflation, par le biais d’une « échelle mobile des salaires », qui jouera son rôle de régulateur.
1971
Première contre-réforme avec la « loi Boulin »
La loi « Boulin », promulguée en 1971, fit passer de 120 à 150 le nombre de trimestres à prendre en compte pour faire valoir ses droits à la retraite.
1983
Mitterrand abaisse l’âge de la retraite à 60 ans.
Folie ? En 1983, malgré la récession, la montée du chômage etc. l’âge de départ en retraite est abaissé à 60 ans (l’âge légal demeurant toutefois fixé à 65 ans), comme promis par Mitterrand dans son « programme commun ». Le taux plein est de 50%, pour 37 ans et demi de cotisations dans un ou plusieurs régimes de base. Les partenaires sociaux décident d’harmoniser les régimes complémentaires sur les mêmes bases. Dans un même mouvement, la semaine de travail est ramenée à 39 heures et la 5e semaine de congés payés généralisée. A cette date, les plus de 80 ans sont 600 000. Leur nombre est passé à environ 1 200 000 en l’an 2000…
1991
Le « Livre blanc sur les retraites » inaugure une série de rapports alarmants sur l’avenir de la retraite par répartition.
Préfacé par Michel Rocard (ce qui en dit long sur le revirement de la doctrine socialiste sur le sujet), le livre alimente le débat entre tenants et opposants de la répartition. La même année est créé l’Observatoire des Retraites qui a pour objet d'encourager l'étude et l'analyse de tous les systèmes de retraites. C’est la même année, également, que Michel Rocard instaure la Contribution sociale généralisée (CSG) à laquelle seront assujettis les retraités en 1998. Après la publication en 1999 du rapport « Charpin » intitulé « L’avenir de nos retraites », suivront le rapport « Teulade » sur l’avenir des systèmes de retraite, rapport « Taddéi » traitant des retraites choisies et des retraites progressives et enfin le rapport « Balligand-de Foucault » situant « L’épargne salariale au coeur du débat social »…
2003
Avec la « Loi Fillon », la retraite par capitalisation montre de nouveau le bout de son nez.
Lors du Conseil européen de Barcelone, en mars 2002, injonction est faite aux Etats membres de fixer l’âge moyen de départ en retraite à 63 ans à l’échéance de 2012 et d’encourager sans délai les « plans d’épargne professionnels » par capitalisation. Un an plus tard, la « Loi Fillon » (ministre de l’Emploi et de la solidarité) incite les Français à se constituer une épargne retraite en supplément des régimes obligatoires. Les sommes sont bloquées jusqu'au départ à la retraite ; elles sont alors versées sous forme de capital ou transformées en rente viagère. En 2004 c’est le lancement du Plan d’épargne retraite populaire (PERP) aux résultats très mitigés : les salariés redoutant les aléas boursiers. L'épargne retraite représenterait pour 2008, tous dispositifs confondus près de 125 milliards d'euros d'encours.
2006
Les premières générations du baby boom arrivèrent à l’âge de la retraite.
C’est en 2006, 60 ans après les ordonnances de 1945, que les premières générations du « baby boom » (1) arrivèrent à l’âge de la retraite - avec une espérance de vie, à 60 ans, de près de 20 ans. Pendant 28 ans, ces générations nombreuses vont s’empiler les unes sur les autres, pesant lourdement sur le système de retraite par répartition, d’autant qu’elles sont remplacées depuis 1974 par des générations moins nombreuses. Ce phénomène est amplifié par le fait que ce sont les classes nées dans les années 1920 qui arrivent à l’âge de la fécondité. Or dans les années 1920, juste avant le ralentissement de la natalité dans les années 1930, il y avait eu une sorte de rattrapage « euphorique » des lendemains de guerre et donc pas mal de naissances. Par ailleurs, L’espérance de vie progresse de 3 mois par an.
(1)En 1946, il y eut environ 200 000 naissances de plus qu’en 1945... Ce très fort taux de natalité se maintiendra en France jusqu’au milieu des années 1970.
2008
La crise financière fait changer l’Argentine de doctrine
Un signe ? L'Argentine, qui avait instauré le système de retraite par capitalisation dans les années 1990, sous Carlos Menem, est revenue à un système de retraites par répartition en 2008 suite à une réforme du gouvernement de Cristina Kirchner. L’adoption, à une écrasante majorité du Parlement, de la loi de nationalisation des retraites proposée par le gouvernement, le 7 novembre 2008, fait suite à la trop grande dépendance du système des aléas des bourses mondiales (qui du reste ont mis l’Argentine sur la paille…).
2010
Le gouvernement remet en cause de l’âge de la retraite et la durée de cotisation.